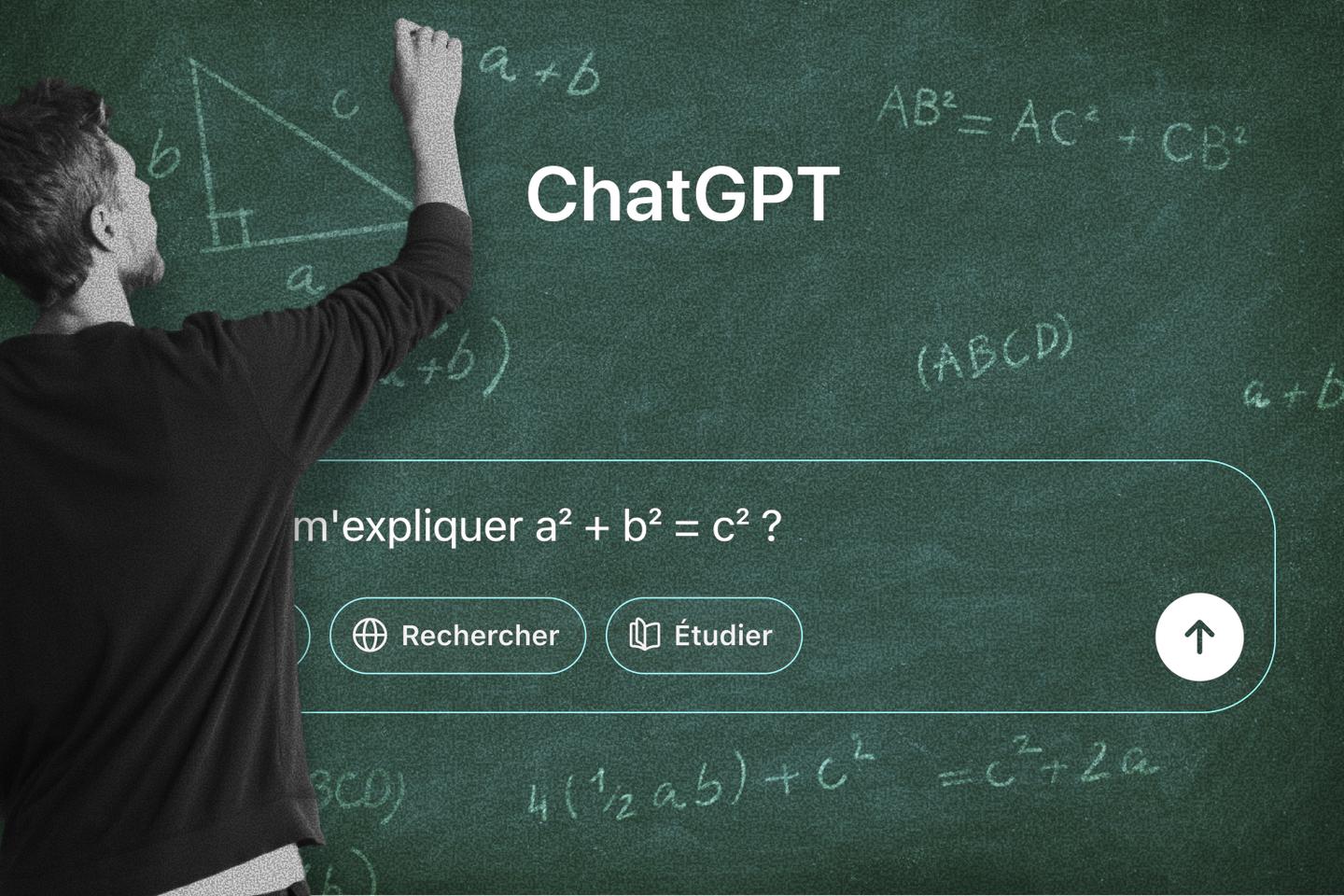« Assimiler l’IA à de la triche dessert l’enseignement et enferme chacun dans un jeu de rôle désespérant »
Comment le système éducatif peut-il tenir encore la barre face au raz de marée des intelligences artificiellesgénératives en langage naturelcomme Le Chat ou ChatGPT ? Quand la version GPT-5.0, dévoilée le 7 août, exhibe un mode d’échange appelé « Prof pédago » qui fleure bon l’euphémisme pour « laisse-moi faire tes devoirs » ? La priorité me semble de sortir ces LLM du régime de la transgression auquel nos élèves et étudiants les associent, et que malheureusement nos discours alarmistes entérinent. De l’imaginaire pirate toujours latent avec l’offreexcitante de ce qu’est devenu l’Internet. A l’adolescence, c’est évidemment une offre irrésistible de pulsionnalité tournée contre la société réglée des adultes. L’assimilation de l’IA générative à de la triche dessert alors l’enseignement, et enferme chacun dans un jeu de rôle désespérant. Alors, oui, la simplicité fulgurante de cette triche par IA est ahurissante pour celles et ceux qui ont pratiqué antisèches en papier ou formules dans la calculatrice : à la simple photo d’un énoncé, ces LLM répondent en une seconde par un corrigé intégral ! Du collège aux concours des grandes écoles, des saisies croissantes dévoilent, comme pour la drogue, l’extension de la pratique. ChatGPT relance d’ailleurs sans gêne les échanges avec des pratiques de dealeur : « Veux-tu un document complet en PDF à montrer à ton prof ? » Lire aussi | Article réservé à nos abonnés « L’IA ne doit pas être un prétexte à l’abandon de l’écriture » Cette normalisation ne peut passer que par une intégration officielle, dont il faut déterminer les modalités et une charte d’usage claire. Il va ainsi falloir repenser les modalités d’évaluation, mieux valoriser encore l’oral en classe, et favoriser le retour à l’atelier de vrais « travaux dirigés ». Et surtout, me semble-t-il, malgré nos propres réserves, insérer cet outil dans une démarche académique, c’est-à-dire dans nos cours. Non pas sur le mode honteux de la cigarette partagée, et pas exclusivement sur celui d’une analyse critique qui paraîtrait trop de mauvaise foi pour dénigrer l’outil, mais pour le défaire de cette dimension transgressive. Ce qui n’implique pas du tout de se soumettre à une divinité pédagogique que l’IA n’est pas. Il vous reste 48.51% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.
#assimiler #lia #triche #dessert #lenseignement
« Assimiler l’IA à de la triche dessert l’enseignement et enferme chacun dans un jeu de rôle désespérant »
Comment le système éducatif peut-il tenir encore la barre face au raz de marée des intelligences artificiellesgénératives en langage naturelcomme Le Chat ou ChatGPT ? Quand la version GPT-5.0, dévoilée le 7 août, exhibe un mode d’échange appelé « Prof pédago » qui fleure bon l’euphémisme pour « laisse-moi faire tes devoirs » ? La priorité me semble de sortir ces LLM du régime de la transgression auquel nos élèves et étudiants les associent, et que malheureusement nos discours alarmistes entérinent. De l’imaginaire pirate toujours latent avec l’offreexcitante de ce qu’est devenu l’Internet. A l’adolescence, c’est évidemment une offre irrésistible de pulsionnalité tournée contre la société réglée des adultes. L’assimilation de l’IA générative à de la triche dessert alors l’enseignement, et enferme chacun dans un jeu de rôle désespérant. Alors, oui, la simplicité fulgurante de cette triche par IA est ahurissante pour celles et ceux qui ont pratiqué antisèches en papier ou formules dans la calculatrice : à la simple photo d’un énoncé, ces LLM répondent en une seconde par un corrigé intégral ! Du collège aux concours des grandes écoles, des saisies croissantes dévoilent, comme pour la drogue, l’extension de la pratique. ChatGPT relance d’ailleurs sans gêne les échanges avec des pratiques de dealeur : « Veux-tu un document complet en PDF à montrer à ton prof ? » Lire aussi | Article réservé à nos abonnés « L’IA ne doit pas être un prétexte à l’abandon de l’écriture » Cette normalisation ne peut passer que par une intégration officielle, dont il faut déterminer les modalités et une charte d’usage claire. Il va ainsi falloir repenser les modalités d’évaluation, mieux valoriser encore l’oral en classe, et favoriser le retour à l’atelier de vrais « travaux dirigés ». Et surtout, me semble-t-il, malgré nos propres réserves, insérer cet outil dans une démarche académique, c’est-à-dire dans nos cours. Non pas sur le mode honteux de la cigarette partagée, et pas exclusivement sur celui d’une analyse critique qui paraîtrait trop de mauvaise foi pour dénigrer l’outil, mais pour le défaire de cette dimension transgressive. Ce qui n’implique pas du tout de se soumettre à une divinité pédagogique que l’IA n’est pas. Il vous reste 48.51% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.
#assimiler #lia #triche #dessert #lenseignement