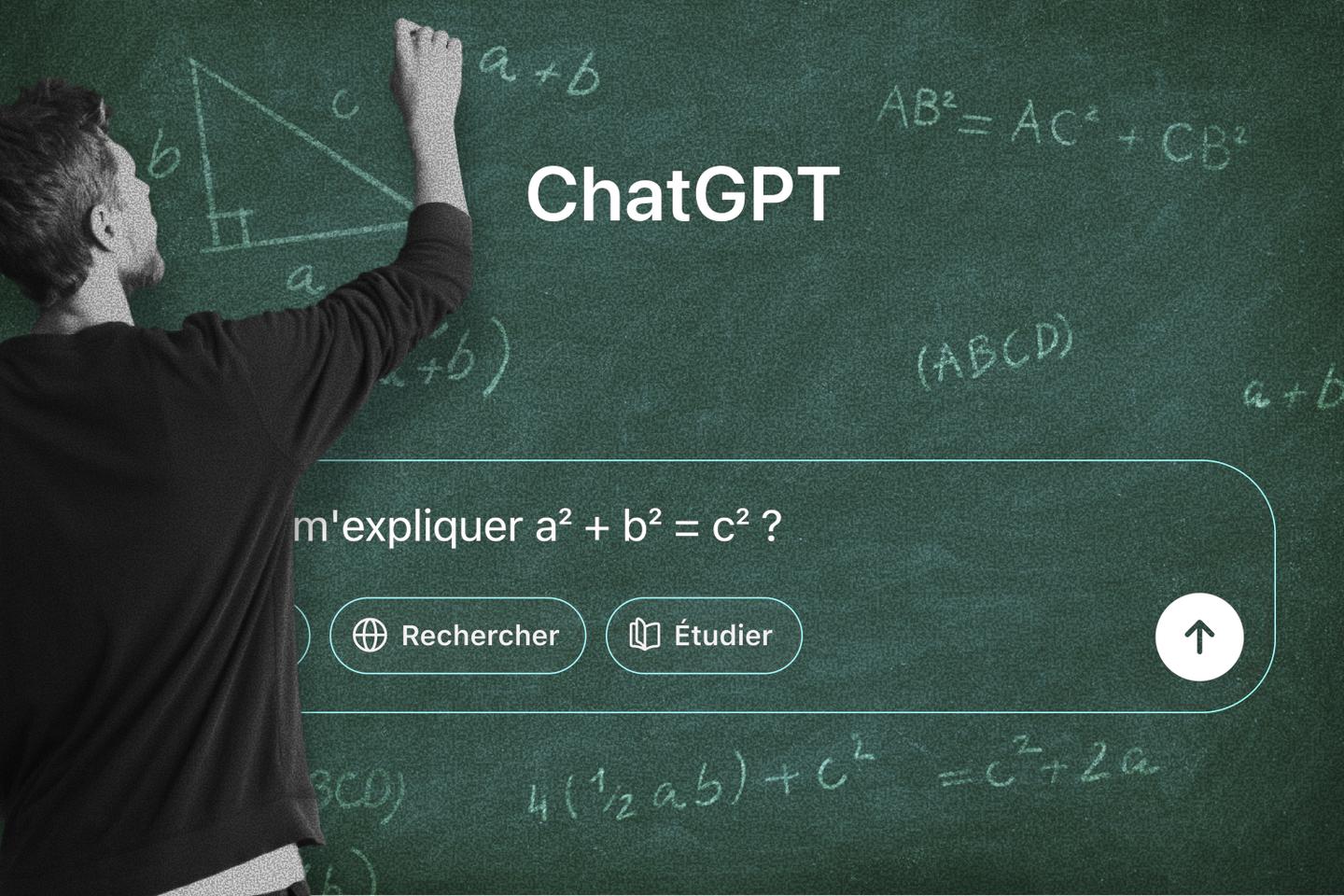« L’IA ne doit pas être un prétexte à l’abandon de l’écriture »
Comme beaucoup de mes collègues universitaires, j’ai terminé l’année avec un sentiment mitigé. D’un côté, la joie de transmettre des savoirs, de voir des étudiants s’approprier des lectures exigeantes et s’enflammer dans des discussions qui dépassent le cadre du cours. De l’autre, la difficulté croissante d’évaluer des devoirs écrits dont je ne sais plus s’ils sont le fruit d’un travail personnel ou d’une intelligence artificielle. En mai, j’ai reçu, dans des proportions inédites, des copies dont le style lisse et impersonnel, la maîtrise surprenante de certaines références pointues trahissaient le recours à l’IA. J’ai aussi entendu, en entretien, des étudiants incapables de résumer avec leurs mots ce qu’ils venaient de m’écrire. Mais j’ai vu dans le même temps des usages plus prometteurs : certains avaient utilisé un logiciel pour générer un contre-argument ou tester la solidité de leurs propres idées. Voilà pourquoi l’interdiction pure et simple du recours à l’IA ne me paraît ni possible ni souhaitable. Chaque grande innovation technique a suscité une sorte de panique morale. Dans l’Antiquité, Platon voyait dans l’écriture une menace pour la mémorisation. Dans les années 1930, la radio fut accusée d’abrutir les masses. La télévision devint, dans les années 1960, le symbole d’un abaissement culturel. Internet fut dépeint comme un espace de désinformation, et Wikipédia comme la fin de l’expertise savante. A chaque fois, ces craintes étaient exagérées : ces technologies n’ont pas provoqué la décadence annoncée. L’IA s’inscrit dans cette lignée. Partenaire plutôt que substitut Le problème n’est pas que les étudiants « trichent » mais que nos dispositifs d’évaluation s’en trouvent fragilisés. Si une dissertation standard peut être produite en quelques secondes, c’est peut-être le signe que ce format n’est plus adéquat pour mesurer l’effort intellectuel attendu. Dans mes cours, j’ai vu cette ambivalence. Lorsqu’ils analysent un discours politique ou un texte scientifique, certains recourent à l’IA pour en produire un résumé. Pris isolément, ce résumé est toujours impeccable, mais souvent plat et sans relief. En revanche, quand les étudiants l’utilisent comme point de départ pour discuter le texte et en repérer les limites, le résultat s’avère stimulant. L’IA devient alors un Il vous reste 59.14% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.
#lia #doit #pas #êtreun #prétexte
« L’IA ne doit pas être un prétexte à l’abandon de l’écriture »
Comme beaucoup de mes collègues universitaires, j’ai terminé l’année avec un sentiment mitigé. D’un côté, la joie de transmettre des savoirs, de voir des étudiants s’approprier des lectures exigeantes et s’enflammer dans des discussions qui dépassent le cadre du cours. De l’autre, la difficulté croissante d’évaluer des devoirs écrits dont je ne sais plus s’ils sont le fruit d’un travail personnel ou d’une intelligence artificielle. En mai, j’ai reçu, dans des proportions inédites, des copies dont le style lisse et impersonnel, la maîtrise surprenante de certaines références pointues trahissaient le recours à l’IA. J’ai aussi entendu, en entretien, des étudiants incapables de résumer avec leurs mots ce qu’ils venaient de m’écrire. Mais j’ai vu dans le même temps des usages plus prometteurs : certains avaient utilisé un logiciel pour générer un contre-argument ou tester la solidité de leurs propres idées. Voilà pourquoi l’interdiction pure et simple du recours à l’IA ne me paraît ni possible ni souhaitable. Chaque grande innovation technique a suscité une sorte de panique morale. Dans l’Antiquité, Platon voyait dans l’écriture une menace pour la mémorisation. Dans les années 1930, la radio fut accusée d’abrutir les masses. La télévision devint, dans les années 1960, le symbole d’un abaissement culturel. Internet fut dépeint comme un espace de désinformation, et Wikipédia comme la fin de l’expertise savante. A chaque fois, ces craintes étaient exagérées : ces technologies n’ont pas provoqué la décadence annoncée. L’IA s’inscrit dans cette lignée. Partenaire plutôt que substitut Le problème n’est pas que les étudiants « trichent » mais que nos dispositifs d’évaluation s’en trouvent fragilisés. Si une dissertation standard peut être produite en quelques secondes, c’est peut-être le signe que ce format n’est plus adéquat pour mesurer l’effort intellectuel attendu. Dans mes cours, j’ai vu cette ambivalence. Lorsqu’ils analysent un discours politique ou un texte scientifique, certains recourent à l’IA pour en produire un résumé. Pris isolément, ce résumé est toujours impeccable, mais souvent plat et sans relief. En revanche, quand les étudiants l’utilisent comme point de départ pour discuter le texte et en repérer les limites, le résultat s’avère stimulant. L’IA devient alors un Il vous reste 59.14% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.
#lia #doit #pas #êtreun #prétexte